C’est reparti : 17h35, début du match.
Tom accuse Lila d’avoir triché. Lila crie que Tom l’a insultée. L’animatrice soupire. Elle rêve d’un café, et sûrement pas de jouer les prolongations.
👉 Bonne nouvelle : on n’est pas obligé de trancher à leur place (même si la tentation est grande de sortir le carton rouge et de tout confisquer).
Ce qu’on peut faire : les accompagner pour qu’ils deviennent eux-mêmes capables de résoudre leurs conflits.
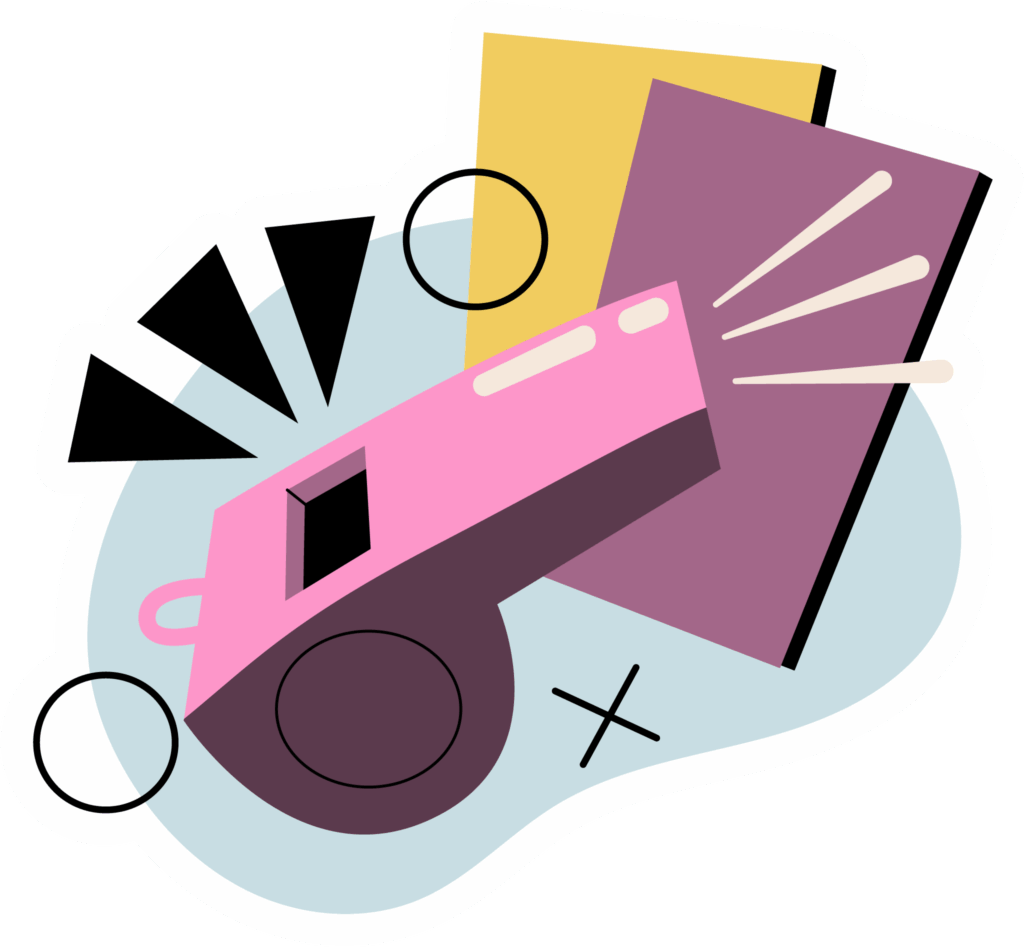
L’arbitre décide, juge, punit.
→ L’enfant n’apprend rien, à part qu’il faut mieux mentir la prochaine fois.
Le médiateur facilite. Il écoute, reformule, encourage la recherche de solution.
→ L’enfant développe ses compétences sociales, son autonomie… et son empathie (si, si, c’est possible).
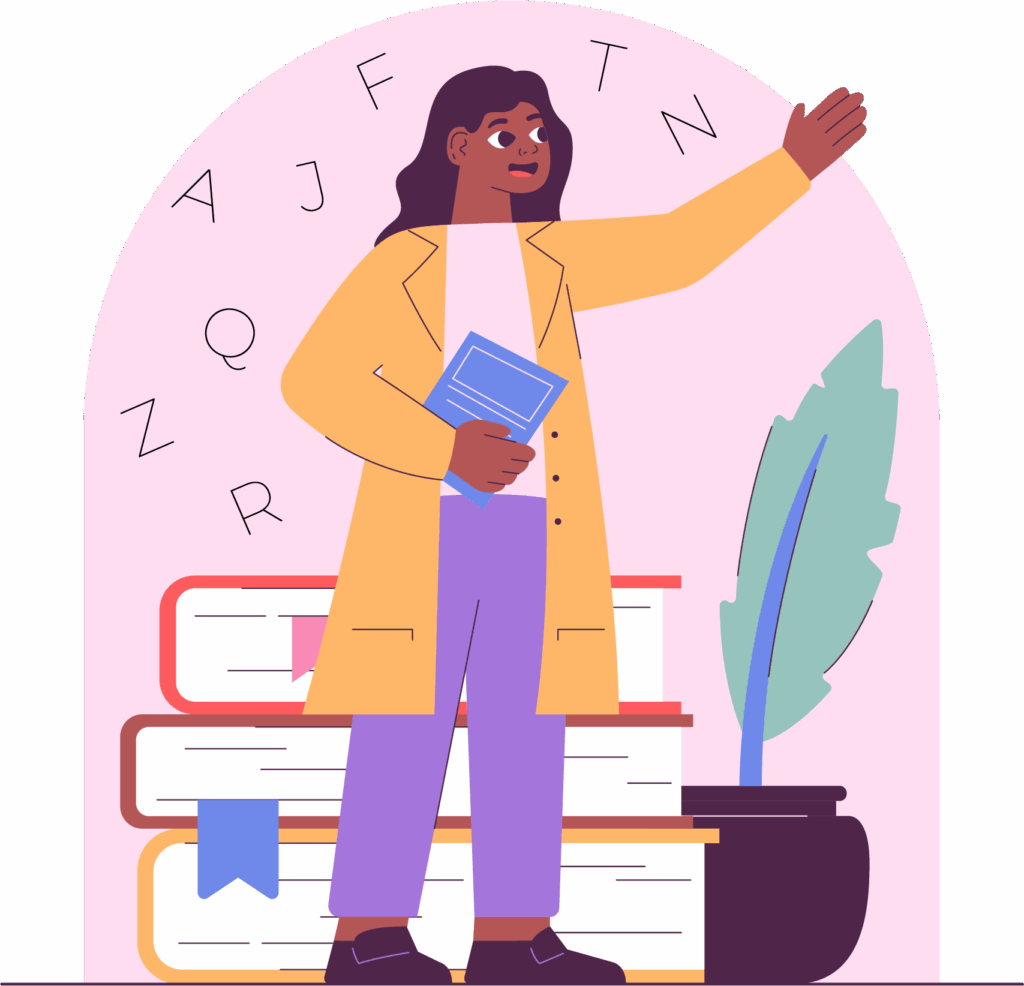
« Raconte-moi ce qu’il s’est passé pour toi. »
On évite les jugements. On permet à l’enfant de confier son émotion et de ne pas se laisser submerger par elle.
« Donc si je comprends bien, vous vous êtes tous les deux sentis frustrés à cause du ballon. »
« Je vous laisse chercher ensemble une solution juste pour chacun. Je suis juste à côté si besoin. » (quand les enfants n’ont pas encore l’habitude de cette pratique, l’adulte reste présent et guide la recherche de solution.)
Oui, même celle qui propose d’envoyer le ballon sur la Lune. L’important, c’est de libérer la parole sans censure.
“On essaie celle-là et si ça ne marche pas, vous pouvez revenir m’en proposer une autre.”
Et si aucun des deux ne veut coopérer ?
🛑 Plan B, pas punitif mais ferme :
« OK. Il existe une solution qui ne vous plaira pas (ni à moi) : je prends l’objet du conflit. »
Rappeler le cadre, sans colère, sans menace. Juste avec cohérence.
Et si, au lieu de demander
« Tu te rends compte de ce que tu lui as fait ? »,
on testait :
« Peux-tu essayer d’imaginer ce qu’il a pu ressentir ? Tu n’as pas besoin d’être d’accord, juste d’essayer. »
📚 Petit rappel des stades d’empathie (oui, le développement affectif ne se fait pas en une nuit) :
À cet âge, l’enfant commence à ressentir ce que l’autre ressent, sans forcément comprendre pourquoi. C’est une empathie « émotionnelle », encore très spontanée.
L’enfant ne fait pas encore bien la différence entre ses propres émotions et celles de l’autre. Il perçoit la tristesse, la peur ou la joie d’autrui, et réagit en miroir.
Ex : Si un camarade pleure, il peut se mettre à pleurer aussi, simplement parce que cette émotion le touche directement.
L’enfant commence à comprendre que l’autre a des pensées et des émotions différentes des siennes. Il ne fait plus qu’éprouver la peine de l’autre : il commence à la comprendre.
C’est le moment où se développe ce qu’on appelle la « théorie de l’esprit » : la capacité à se représenter ce que l’autre ressent ou pense.
Ex : Il comprend qu’un camarade est triste parce qu’il a perdu un jouet, même si lui ne trouve pas ça grave.
L’enfant intègre des valeurs morales et une compréhension sociale plus larges. Il ne s’agit plus seulement de comprendre ou de ressentir ce que l’autre vit, mais de se sentir responsable du bien-être d’autrui et d’agir en conséquence.
Il comprend que certaines actions peuvent blesser moralement et qu’il existe des principes de justice, de respect, de solidarité.
Ex : Il réfléchit à ce qui est « juste » : « Si c’était moi, j’aimerais qu’on m’aide. »
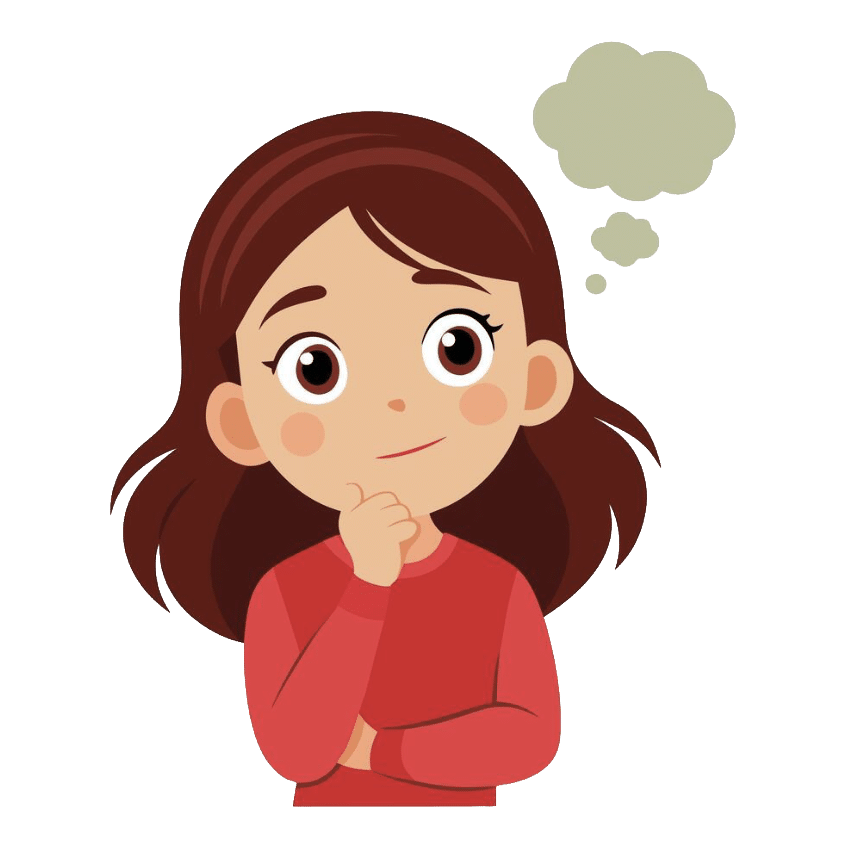
Découvrez nos conférences sur :
– Jalousie, rivalité et conflits dans la fratrie (qui peut être adaptée à la collectivité)
– Mieux vivre avec les autres, ça s’apprend – le super pouvoir des compétences psychosoiales